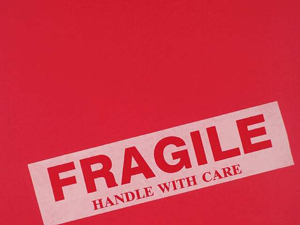Le gouvernement a annoncé une réforme du régime général de retraite. Ce projet est déséquilibré, injuste et en plus, il ne résout pas le problème. C’est une réforme à courte vue, non financée, qui n’a pas été négociée avec les syndicats. Comme tous les salariés, les navigants sont directement touchés par ces remises en cause.
De tous les débats économiques, la question des retraites et des mesures qui sont prises pour préserver les régimes de retraite constituent sans aucun doute l’indicateur le plus révélateur des choix d’avenir d’une société.
L’allongement de l’espérance de vie, d’une part, la persistance d’un taux de chômage élevé, d’autre part, provoquent un déséquilibre structurel grave du régime général de retraite (retraite sécu de la CNAV) des salariés.
Ce déséquilibre risque de générer de profondes inégalités en poussant les plus fortunés à privilégier les retraites par capitalisation et en pénalisant ceux qui ont connu de longues périodes de chômage.
Une fois de plus, on peut craindre que des enjeux de court terme (élections, postures politiques et/ou syndicales) ne prennent le pas sur le véritable enjeu de cette réforme : assurer le meilleur niveau de pension aux retraités, dans un système par répartition entre les quatre générations qui cohabitent dans une même société.
LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Après deux mois d’une communication millimétrée, le gouvernement a présenté son projet de réforme des retraites.
La mesure phare du projet est le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite qui va passer, d’ici à 2018, de 60 ans à 62 ans.
Rappelons que l’âge légal de la retraite est l’âge à partir duquel un salarié est en droit de demander sa retraite.
Un salarié ne perçoit sa retraite à taux plein que si sa durée d’assurance est d’au moins 41 ans. À défaut d’avoir validé 164 trimestres (41 ans), un salarié peut bénéficier de sa retraite à partir de 60 ans, mais avec un abattement. À 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés, la retraite est versée à taux plein.
Le projet de réforme annoncé par le gouvernement, repousse également cette deuxième borne, l’âge de la retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance, à 67 ans !
De plus, non seulement ce projet repousse de deux années les deux seuils de 60 et de 65 ans, mais il augmente aussi la durée d’assurance minimum. Aujourd’hui de 160 trimestres, elle devrait être portée à 165 trimestres pour les générations de 1953 et 1954 et à 166 trimestres en 2020.
UNE INJUSTICE CERTAINE !
Augmenter l’âge légal de la retraite c’est augmenter les inégalités en faisant cotiser plus longtemps ceux qui entrent tôt sur le marché du travail. Ce sont bien souvent les salariés les moins qualifiés et les plus modestes. Ceux qui ont les conditions de travail les plus usantes, ceux dont l’espérance de vie est la plus faible.
Et encore s’agit-il ici d’une vision optimiste (!) car, pour la majorité des salariés, ce recul de l’âge à partir duquel ils peuvent réclamer une pension de retraite se traduit par deux ans de chômage (éventuellement non indemnisé) supplémentaires. En effet, 68 % des Français de 60 ans sont au chômage !
Cette réforme consiste donc à transformer de « jeunes » retraités en « vieux » chômeurs !
Comme le disent certains économistes : on transfère le mistigri des déficits des caisses de retraite aux caisses de l’Unedic, le régime d’assurance-chômage.
En effet, si la question des retraites est évidemment un problème démographique, c’est également une problématique liée à l’emploi. Le recul de l’âge légal de la retraite n’empêchera pas les employeurs de virer les « vieux » pour, au mieux, envisager l’embauche d’un jeune stagiaire peu ou pas rémunéré, et sans cotisations sociales.
ABSENCE DE NÉGOCIATION
C’est un passage en force du Gouvernement qui dès le début a annoncé sa volonté de reculer l’âge légal de la retraite. Il ne restait plus ensuite qu’à débattre du futur nouvel âge, 62, 63 ou 64 ans. Ni les syndicats, ni les manifestations n’ont pu pour l’instant faire revenir le gouvernement sur sa position.
Le sujet aurait pourtant mérité des discussions plus approfondies. Faut-il conserver le système que nous connaissons et se contenter de ne faire qu’une réforme « paramétrique » ? Faut-il reconstruire complètement le système lui-même ? Si le système est à bout de souffle, il faut prendre le temps d’en imaginer un autre. Même s’il faut un an ou deux de négociations pourquoi pas ?
Entre les influences idéologiques certaines, la pression des marchés financiers et la perspective de la prochaine élection présidentielle, peu de place a été laissée pour une véritable négociation.
D’AUTRES PISTES
Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas lancé la réflexion, l’étude, et la négociation sur un système de retraite à la carte ? En Suède, par exemple, les réformateurs ont mis deux ans à « réfléchir » à la création d’un nouveau système de retraite par répartition (le système des comptes notionnels) et ensuite 5 années supplémentaires avant la mise en place complète de la réforme. Ce système a été, depuis, mis en place dans plusieurs pays européens, mais malheureusement il n’y a pas de débat national sur une telle réforme structurelle de notre retraite.
Même en ne faisant qu’une réforme touchant aux seuls paramètres de calcul et d’attribution des retraites, il aurait sans doute été possible d’aboutir à un consensus (au moins de rechercher ce consensus). Mais, à condition de quitter les postures dogmatiques. C’est ainsi que, même la question de l’âge légal de retraite aurait pu ne pas constituer un tabou si son recul s’était accompagné d’aménagements pour les plus faibles.
Et si cet âge légal continuait à poser problème, pourquoi ne pas le supprimer pour ne plus raisonner qu’en termes de durée d’assurance ? On laisserait ainsi la liberté de choix aux salariés : ceux qui ont commencé tôt partiraient quand ils le souhaitent en faisant un choix entre valeur de la pension et durée de carrière, en fonction de leur espérance de vie.
Un simple système de décote/surcote, ne coûtant rien aux finances du système de retraite, redonnerait à chacun son libre choix.
Pourquoi réduire autoritairement l’ensemble des choix possibles en définissant pour tout le monde un recul de deux années avant de pouvoir bénéficier d’une pension ?
PÉNIBILITÉ
Le projet de réforme prévoit un droit à départ anticipé (60 ans) avec une pension complète (quelle que soit la durée d’assurance accomplie) à condition de justifier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 20 %.
Certains métiers provoquent une usure prématurée des salariés qui a des effets indiscutables sur l’espérance de vie, mais cela ne se voit pas forcément à 60 ans ni même à 62 ans.
En conditionnant le départ anticipé à une usure déjà constatée, le gouvernement met une exigence qui relève plus des accidents du travail et des maladies professionnelles que du système de retraite.
Sur environ 700 000 départs en retraite par an, cette disposition concernerait approximativement 10 000 personnes seulement.
En savoir plus…